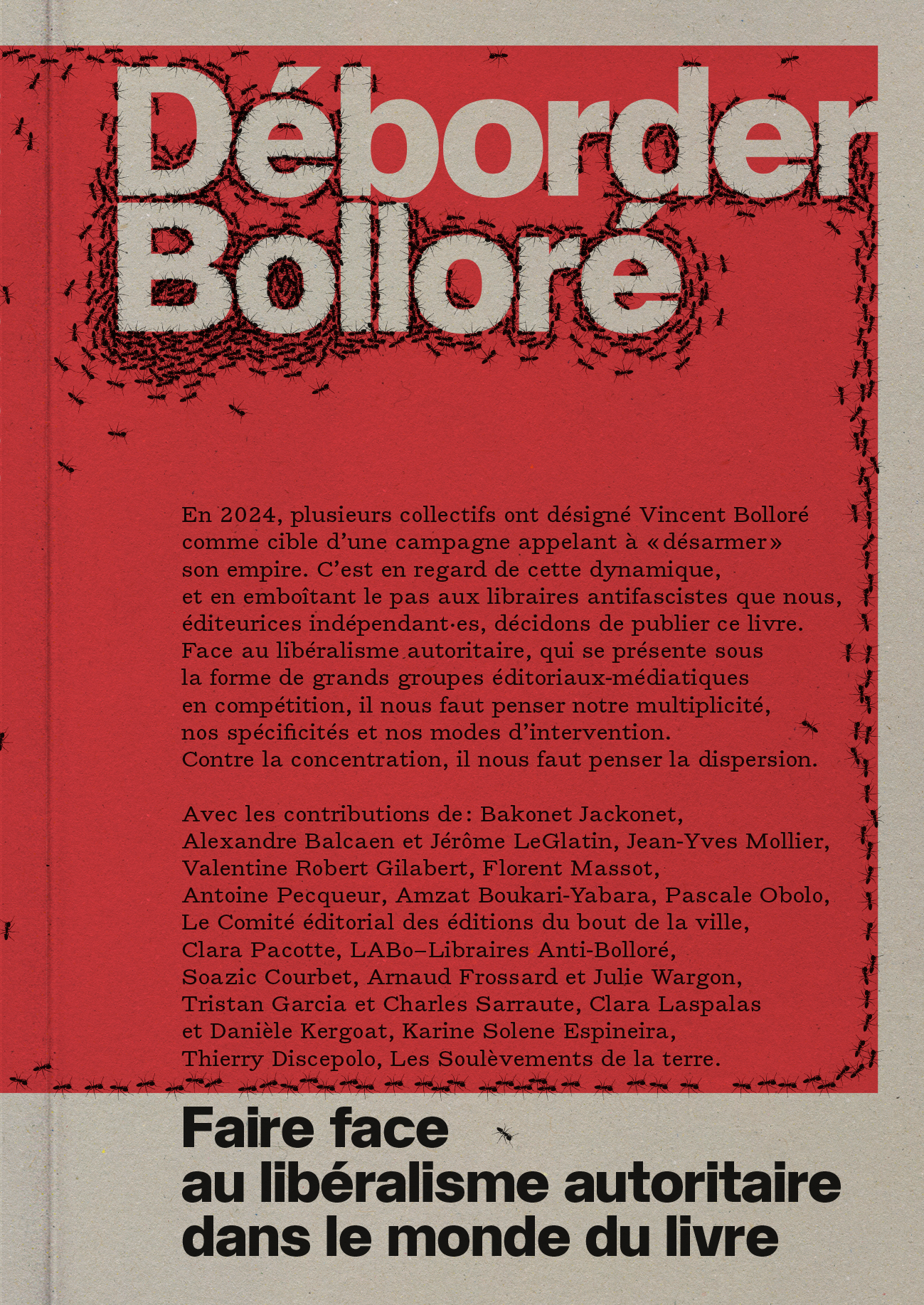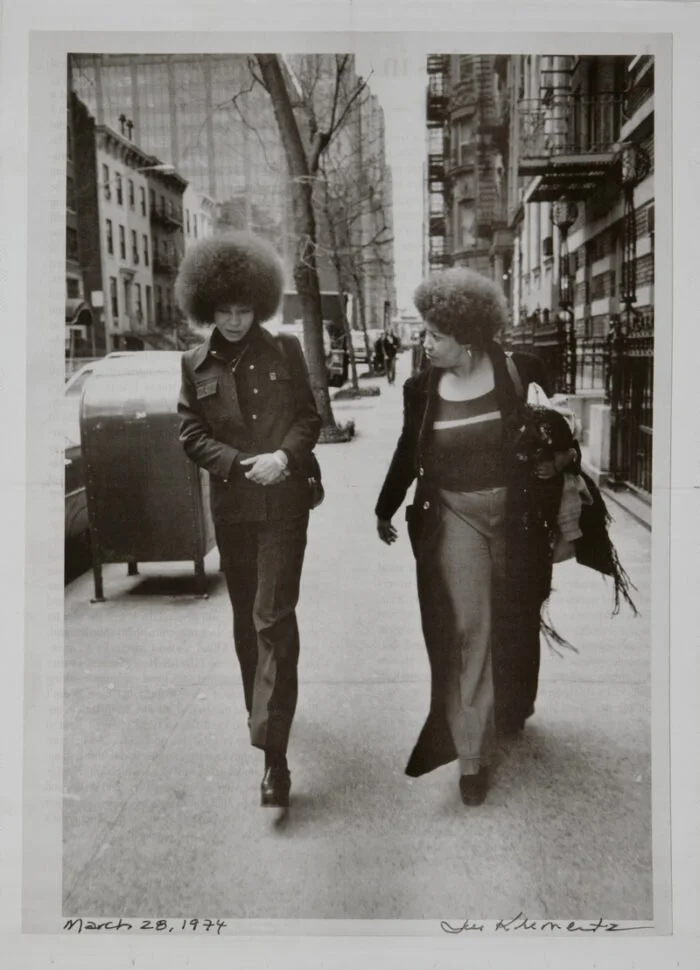ÉCRIRE À CONTRE-POUVOIR
Cet article inaugure une série consacrée aux enjeux de l’édition féministe, queer, antiraciste et anti-impérialiste indépendante. Il s’intéresse plus particulièrement à la place des auteur·ices, maillon central mais fragile de la chaîne du livre, dont la marge de manœuvre éditoriale est étroite, contrainte par la précarité du métier et des rapports de force inégaux : contrats verrouillés, absence de sécurité de revenus, droits d’auteur faibles. Écrit depuis mon regard de personne qui écrit, édite et traduit, il invite à repenser ce qu’est un·e auteur·ice, à sortir d’une vision hiérarchisée pour envisager tout le spectre des travailleur·ses du texte : auteur·ices, éditeur·ices, correcteur·ices, traducteur·ices, graphistes, et à reconnaître la valeur de ce travail collectif, souvent invisible, qui fait exister un livre. Le texte s’appuie sur les enjeux du boycott face à la concentration éditoriale capitaliste, la fragilité des auteur·ices et tentatives de résistance collective pour réfléchir à la manière dont l’émancipation éditoriale peut naître depuis les marges.
Leslie Feinberg / Beacon Press
En 2012, à contre-courant de la littérature soumise aux logiques marchandes, Leslie Feinberg fait un choix politique radical : rendre son best-seller Stone Butch Blues, un classique de la littérature queer et trans initialement publié en 1993, disponible gratuitement en ligne et interdire toute exploitation commerciale après une longue bataille pour récupérer ses droits. Sa décision s’inscrit dans une démarche de libération des idées : « give [Stone Butch Blues] back to the workers and oppressed of the world », écrira iel, affirmant son refus de voir la lutte trans et ouvrière être assujettie aux logiques marchandes. En France, une traduction du roman publiée par le collectif Hystériques & AssociéEs en 2019, rend l’intégralité du texte disponible gratuitement en ligne, tout en imprimant une édition papier vendue à prix coûtant, dans la continuité politique du geste original de l’auteur·ice et militant·e trans et antiraciste. Au-delà des personnes qui, comme Leslie Feinberg, souhaitent totalement faire sortir leur littérature des sphères commerciales, d’autres, partout dans le monde, essaient d’élargir leur marge de manœuvre au sein même de leurs dispositions contractuelles pour tenter de vivre de leur écriture de manière plus éthique et confortable pour des personnes déjà victimes de sexisme, de racisme, transphobie ou homophobie. Mais interrogeons-nous, tout de même : est-il si lunaire d’imaginer que le travail d’écriture ne dépende plus des règles capitalistes et succès commerciaux ?
Un peu de contexte sur les luttes éditoriales en cours
En France, les actions face aux logiques de concentration et d’indépendance éditoriale se sont illustrées à plusieurs reprises ces dernières années. En 2020 déjà, éditeur·ices indépendant·es et distributeurs annonçaient ne plus vendre leurs livres sur Amazon, assumant de prendre des risques économiques considérables pour défendre leur autonomie, et soutenant au passage le circuit des librairies indépendantes. En 2021, le collectif Éditer en féministes se crée pour questionner l’intérêt soudain des grands groupes pour les livres féministes en pleine vague MeToo et invite à la vigilance pour le jour où le féminisme ne serait plus “à la mode”. Dans le même temps, le collectif “Stop Bolloré“ s’organise face à la concentration éditoriale du groupe Editis. En 2023, la “guerre idéologique” menée par Vincent Bolloré en prenant le contrôle de Hachette monte d’un cran, ces stratégies on ne peut plus claires de verrouillage éditorial et médiatique menaçant la démocratie, indigne jusqu’aux auteur·ices de renom. Annie Ernaux le déclare : « Je n’apporterai en aucun cas ni ma voix, ni ma plume, à un média ou une maison d’édition sous l’emprise de quelqu’un sapant les valeurs démocratiques. » Nombreux·ses se disent prêts à boycotter ses maisons d’édition ou à refuser des interviews dans ses médias. Toujours en 2023, Les Soulèvements de la Terre déclenchent la campagne Désarmer Bolloré. En novembre 2024, 80 librairies annoncent boycotter Hachette en ne vendant plus ses livres. En 2025, plus d’une centaine de maisons d’édition indépendantes s’allient autour de Déborder Bolloré pour analyser et répondre aux dynamiques de concentration et d’extrême droitisation du marché, depuis la perspective de chercheur·euses, imprimeur·euses, éditeur·ices et libraires.Parallèlement à ces remous, beaucoup se rejoignent politiquement mais certain·es souhaitent y apporter un regard plus nuancé : Comment boycotter ? C’est la question que pose la journaliste Pauline Le Gall en juin 2025 dans les Inrocks, qui cite la libraire Soazic Courbet dans le recueil Déborder Bolloré : “Quand on appelle au boycott de Bolloré, on s’attaque à 10 % du problème de la fascisation et de la précarité du monde du livre. Il y a toute une structuration à changer pour que tout le monde puisse survivre, et pas seulement les gros investisseurs.” Dans son article, elle rappelle, citant Armelle Laborie, que le boycott a surtout une valeur informative. Que faire, au-delà du boycott ? Pour beaucoup de personnes de l’interprofession, toutes ces opérations servent en grande partie à se connaître, s’allier, et voir à mutualiser ses forces et matérialités. On y reviendra.
Et la place des auteur·ices, dans tout ça ? En août 2025, la campagne « Déserte Hachette » est lancée sur Instagram via le compte Cher·e auteur·ice et sur le site Désarmer Bolloré. Invitant au boycott cette fois-ci mené par des auteur·ices, elle interpelle particulièrement les écrivain·es dont la notoriété leur donne la possibilité de choisir leur maison d’édition pour les interroger sur leur décision de publier chez un éditeur contribuant au projet réactionnaire de Vincent Bolloré : Mona Chollet, Marie Darrieussecq ou Alice Zeniter. “Parmi les dizaines de romans publiés par les maisons d’éditions du groupe Hachette dès la fin août, on retrouvera avec tristesse des auteur.ices qui nous sont cher.es, et avec qui l’on pensait partager à priori nos idéaux politiques. Iels publient des livres qu'on aurait hâte de découvrir s’ils ne finançaient pas un monde sans lendemain”. Le texte interroge : “Qu’est-ce qu’iels font ?”. La méthode : inviter qui le souhaite à adresser une lettre via une interface. Ses initiateur·ices défendent le fait qu’aucun courrier harcelant ou violent ne sera transmis, et argumente sur la dimension collective via des interpellations individuelles : “Il est probable que le courage de la sécession soit difficile à trouver quand on écrit son livre, seul.e et isolé.e. Quand on se sent tenu.e par certains liens de travail et de confiance déjà formés. Quand on évolue dans un monde d’idées au point d’oublier que le livre a malgré tout une existence matérielle et sociale. À nous de provoquer ce courage, par contagion, par la pluralité et la masse de nos missives.” Mais pour les auteur·ices précaires, la démarche suscite des critiques. Pour Tal Madesta, auteur publié chez Binge Audio, La Déferlante et journaliste, « concentrer cette campagne sur la responsabilité individuelle des auteur·ices, c’est ignorer complètement l’écosystème économique dans lequel on est pris·es. Le post visait évidemment les onze auteur·ices de gauche les plus connu·es, mais je trouve que politiquement ce n’est pas très opérant de s’adresser à onze personnes plutôt que de construire un mouvement collectif autour de questions comme l’accès aux droits sociaux ou la rémunération continue. C’est une approche très morale du problème qui laisse croire que les auteur·ices ont une réelle marge de manœuvre, ce qui n’est tout simplement pas le cas pour 99 % d’entre nous. » Pour la majorité des écrivain·es, dire « non » n’est alors pas une option. Idem pour l’autrice Pauline Harmange, dont le parcours éditorial est devenu emblématique au début de MeToo. Elle publie Moi les hommes je les déteste en 2020 dans la micro-maison d’édition Monstrograph, créée par Martin Page et Coline Pierré. Tiré à seulement 400 exemplaires, le livre aurait pu rester confidentiel, si Ralph Zurmély, haut fonctionnaire au ministère chargé de l’égalité femmes-hommes, n’avait pas menacé de l’interdire pour incitation à la haine. La polémique l’a aussitôt propulsé sous les projecteurs : il a été réimprimé, traduit, puis racheté par Fayard (Hachette). « J’ai un frigo à remplir, une enfant à nourrir. Comme tout le monde, je travaille pour vivre. Je suis une grande défenseuse de l’édition indépendante et 50 % de mes livres sont publiés par des éditeur·ices indépendants. Mais où est l’argent ? Déjà pas de ouf dans les grands groupes, mais alors pas du tout dans les petites maisons. (…) Les idéaux sont une boussole, pas une destination. On fait de notre mieux sur un chemin semé d’embûches infiniment plus grandes que nous. Je pense qu’il faut recommencer à croire en l’humain. Recommencer de croire que chacun, chacune, fait du mieux qu’iel peut, jusqu’à preuve du contraire, et sortir des logiques d’inquisition. » commente-t-elle.
Ouvrage collectif, Déborder Bolloré, coédition collective, CC BY–NC–ND, 2025.
Où est l’argent ?
Là où Bolloré et consorts veulent bien le mettre. Et dans la chaîne du livre, rien n’est laissé au hasard. Imaginez un gâteau. Dans l’édition française, le prix d’un livre se découpe en parts précises : environ 35 à 40 % pour la librairie, 10 à 15 % pour la distribution, 20 à 25 % pour la maison d’édition, et 8 à 12 % pour l’auteur·ice. À chaque achat, c’est donc tout un écosystème qui est nourri par le chiffre d’affaires généré par ce produit commercial, à l’exception de l’auteur·ice, qui perçoit des droits sur son œuvre. La répartition peut être radicalement différente lorsque le livre est publié dans une maison appartenant à un grand groupe comme Hachette : seulement 8 à 10 % reviennent à l’auteur·ice, et tous les autres revenus (hors TVA) alimentent le fonctionnement du groupe pour financer diffusion, distribution, médias partenaires, réseaux de communication, et même certaines librairies. De plus, que le livre se vende ou non, tout le monde touche a priori un salaire chaque mois et bénéficie des protections sociales correspondantes. Autrement dit, l’écrivain·e incarne la figure la plus précaire d’un système qui protège avant tout ses structures.
Mais tout ce système d’équilibre et la puissance éditoriale qui va avec n’est que fictive : leur rentabilité ne repose pas sur les ventes de livres. Protégées par les capitaux et activités extérieures du groupe, les grandes maisons sont souvent si éloignées de tout risque financier qu’elles publient des ouvrages sans toujours prendre la peine de les défendre (ou sans les défendre tout court) : promotion, le suivi, les rencontres en librairies ou les relations presse, alors même qu’elles en ont les moyens. Peu importent les ventes, peu importe l’auteur·ice, peu importe la surproduction. Pour un groupe comme Hachette, l’enjeu n’est pas la lucrativité éditoriale, mais l’extractivisme des idées, l’emprise et le contrôle des imaginaires. Bolloré, lui, va chercher ses profits ailleurs : rachat de ports en Afrique, investissements dans l’industrie de l’armement, domination sur des infrastructures stratégiques. Acheter un livre issu de cette méthode de production, c’est certes octroyer un soutien extrêmement temporaire envers un·e auteur·ice ou permettre à une éditrice féministe de toucher son salaire, mais surtout alimenter un empire politico-éditorial-médiatique qui verrouille la visibilité et concentre les richesses.
Du côté des maisons indépendantes, la question de savoir où se trouve l’argent est évidente : plus ou moins nulle part, puisque leur modèle économique repose seulement sur la vente de livres. Cela n’empêche pas de nombreux·ses éditeurices de faire leur maximum pour octroyer des à-valoirs décents (mais jamais aussi hauts que dans les groupes, c’est vrai) et des pourcentages de droits d’auteur généralement plus élevés. Les projets de livres se financent un peu grâce à des aides publiques nationales et régionales quand elles le veulent bien, du côté de fondations aussi (amenant son lot de questionnements éthiques) - et bien sûr des ventes.
Pour les auteur·ices qui doivent garantir un minimum de rentrées d’argent, la tendance est évidemment à négocier l’à-valoir le plus élevé possible, afin que la maison d’édition, indépendante ou non, endosse le risque financier. Les maisons indépendantes prennent alors à la fois ce risque financier pour rester compétitives face aux « monstres » éditoriaux, à la fois le risque éditorial que les grandes maisons ne prendront pas : publier des voix ou des formats jugés trop peu bankables, quitte à ce que ces mêmes grandes maisons rachètent ensuite les droits. Le fameux système des « rachats en poche » illustre de manière criante comment le travail des indés est exploité par les grands groupes : lorsqu’un titre déjà paru les intéresse, ils n’ont qu’à racheter les droits pour des cacahuètes, capitalisant sur le premier succès de l’auteur·ice et tout le travail éditorial accompli dans des conditions précaires, voire gratuitement.
Au-delà de savoir où va l’argent, qui me semble être une vision court-termiste (et on n’y échappe difficilement), interrogeons-nous aussi sur la manière dont sa circulation est organisée dans un système si verrouillé. Comment ne pas comprendre que pour les auteur·ices qui souhaitent vivre de leur écriture, devoir choisir entre structure indépendante ou non n’est absolument pas prioritaire - tant que leur statut restera aussi précaire ? “On a un problème d’absence de continuité salariale et d’absence de certains droits sociaux dont le chômage. Nos salaires ne sont même pas des salaires puisqu’il s’agit d’avances sur ce qu’on va potentiellement vendre : il y a tout ce système de rémunération à revoir prioritairement si on veut que les auteurices aient un poids dans le rapport de force. Là on n’a aucun poids dans le rapport de force parce que pour l'instant, les conditions de rémunération dans le secteur de l'écriture ne sont pas concordantes avec le temps de travail dégagé.” explique Tal Madesta. Dans les deux cas, les auteur·ices restent rémunéré·es uniquement en fonction du succès commercial de leurs livres. Leur travail n’est pas reconnu comme tel : ce qui est valorisé, c’est le livre comme produit et la rente générée par l’œuvre, pas le temps, l’effort et la créativité investis pour le créer.
Travail invisible
Cette logique du marché ne se limite pas à la vente : elle structure toutes les étapes de la production, valorisant surtout ce qui rapporte et laissant dans l’ombre l’énorme quantité de travail invisible nécessaire pour qu’un livre voie le jour. C’est ce travail préparatoire et souvent non rémunéré qui nourrit la chaîne éditoriale et mérite enfin d’être reconnu.
Prenons un exemple : la manière dont le monde de l’édition a réagi à “MeToo”. Partout, l’urgence est au dire. Le flot de contenus sur Instagram, loin d’être neutre, devient un entraînement à l’acceptation du travail gratuit, un terreau fertile à exploiter sous forme de livres. Pour les grands groupes, c’est du pain béni : leurs larges fenêtres de visibilité leur permettent de promouvoir primo-essayistes et romancièr·es tout en ayant un accès direct à de nombreuses théorisations des luttes. Mais c’est aussi une opportunité de rebattre les cartes : faire en sorte que la production éditoriale ne soit plus la chasse gardée d’universitaires ou de personnes privilégiées dont le salaire ne dépend pas de la production de livres, et ouvrir ainsi le monde du livre à des militant·es et aux personnes concernées par leurs sujets. Je dois bien admettre qu’avant d’écrire et d’éditer avec l’expérience que j’ai aujourd’hui, voir chaque nouveau livre féministe remplir les rayons des librairies me remplissait de joie. La manière dont un livre était produit restait alors au rang de l’impensé. C’est en me professionnalisant, en reliant étroitement mes pratiques à mes réflexions féministes, que j’ai compris que produire un livre est déjà un engagement, même au sein du monde capitaliste. Ne pas prendre en compte l’envers du décor, les coulisses de production dans les luttes, ne mènera jamais nulle part. Après plusieurs années qui ont surtout fait le beurre des maisons de ces groupes tout en contribuant à l’extrême-droitisation en défendant des titres aux idées opposées, des collections entières ont été ouvertes et s’ouvrent encore sur des lignes éditoriales féministes, queer et antiracistes, reposant sur l’accessibilité directe des sujets soulevés par les luttes, avec les budgets qui vont avec.
Mais les réseaux sociaux sont loin d’être le seul endroit où s’accumule un travail invisible. Dans l’édition, savoir présenter un projet clairement et efficacement est presque aussi important que l’écriture elle-même : le fameux pitch. Pour s’adresser aux maisons d’édition ou agent·es littéraires, les auteur·ices doivent rédiger une note de synthèse pour convaincre, avant même que le manuscrit complet ne soit lu. Cela implique de condenser des mois, parfois des années de travail en quelques lignes, de faire ressortir le ton, l’originalité et la qualité narrative du projet. Autrement dit : apprendre à se vendre, à se marketer. Comment reconnaître ce travail comme une étape créative légitime et rémunérable, capable de valoriser l’ensemble du processus, de la conception à la publication ? Le temps consacré à monter des dossiers pour des résidences d’écriture en fait aussi partie, et il pèse lourd, même si ce travail est rarement pris en compte. Pour certains genres, comme le roman, la situation est encore plus pesante : il faut écrire l’œuvre entière pour espérer une publication. Là, le travail invisible devient le plus lourd : des mois, parfois des années, investis avant toute garantie de rémunération, simplement pour que l’éditeur·ice puisse évaluer le style, le ton et la cohérence de l’ensemble. Qui peut se le permettre ? Quelles voix parviennent à être entendues, et quelles voix restent écartées par ce filtrage implicite ?
Angela Davis et Toni Morrison par Jill Krementz (1974)